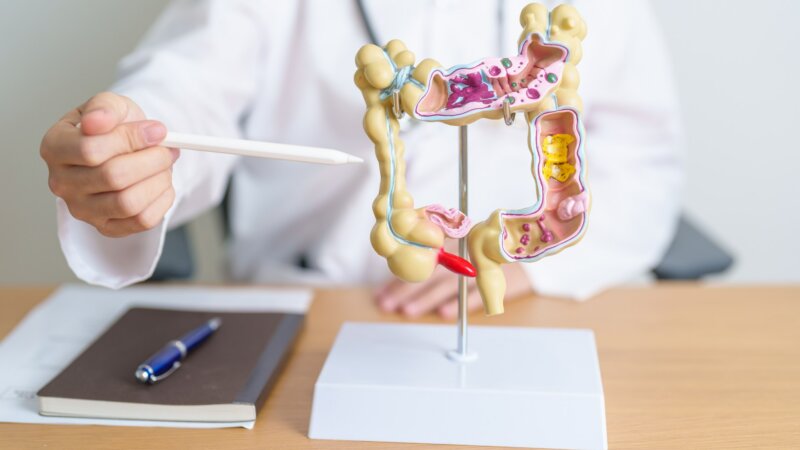Alimentation : qu’est-ce que l’hexane dont Greenpeace demande l’interdiction ?

L’hexane est un hydrocarbure appartenant à la famille des alcanes. Utilisé pour extraire l’huile contenue dans les graines oléagineuses (colza, soja, tournesol…), il est omniprésent dans les procédés industriels de production d’huiles végétales (hors productions bio).
Les graines sont d’abord broyées puis mises en contact avec de l’hexane, qui va capturer l’huile qu’elles contiennent. Ce procédé industriel permet d’extraire jusqu’à 97 % de l’huile présente dans les graines, contre seulement 89 % avec les méthodes mécaniques traditionnelles comme la pression à froid. Ce qui permet d’optimiser les rendements industriels.
Problème, des résidus d’hexane se retrouvent dans les tourteaux de colza, de tournesol ou encore de soja. Ces produits riches en protéines, destinés à nourrir les animaux d’élevage (volailles, porcins et bovins), sont obtenus lors de l’extraction de l’huile. Après ingestion le bétail, des traces de ce solvant peuvent être présentes dans les produits consommés par les humains. La question de son innocuité se pose donc.
« Nous avons réalisé des tests sur une variété de produits alimentaires dont les résultats sont sans appel : nos aliments du quotidien sont contaminés à l’hexane », explique Sandy Olivar Calvo, chargée de campagne Agriculture à Greenpeace.
Ainsi, le travail mené par l’ONG révèle que près de deux tiers des produits testés (36 sur 56) contiennent des résidus d’hexane. Sa présence a été détectée dans des produits de consommation courante comme le lait infantile, le beurre ou le poulet.
Retrouvez les résultats détaillés des produits testés en cliquant ici.
Un flou sur la toxicité
Pour Greenpeace, « cette utilisation massive de l’hexane fait peser un risque majeur sur la santé publique puisque cet hydrocarbure est une substance neurotoxique avérée, suspectée d’être reprotoxique et un potentiel perturbateur endocrinien. Il est d’ailleurs classé comme substance CMR (cancérogène, mutagène, reprotoxique) par l’ECHA (Agence européenne des produits chimiques). »
Mais à l’heure actuelle, ni l’autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), ni l’Anses ne disposent de valeur toxicologique de référence (VTR) pour l’exposition à l’hexane par voie orale.
En septembre 2024, l’EFSA a d’ailleurs publié un rapport technique concluant à la nécessité de mettre à jour l’évaluation concernant la sécurité de l’utilisation de l’hexane en tant que solvant d’extraction pour la production de denrées alimentaires.
En février 2025, interpellé sur cette question à l’Assemblée nationale, le gouvernement a répondu que «dans un objectif de maintien d’un niveau élevé de protection de la santé publique et de la sécurité sanitaire des aliments, la France soutiendra une saisine de l’EFSA par la Commission, afin de réévaluer l’hexane utilisé en tant qu’auxiliaire technologique dans la production de denrées alimentaires, de façon, si nécessaire, à revoir son utilisation telle qu’elle est actuellement prévue par la directive 2009/32/CE. »
Une réglementation insuffisante ?
Autre sujet de discorde, bien que l’hexane soit présent dans de nombreux aliments, les consommateurs n’en sont jamais informés. La raison ? Il est classé comme « auxiliaire technologique » par la réglementation européenne, ce qui signifie qu’il n’a pas à figurer sur les étiquettes des produits. Elément normal pour Hubert Bocquelet, délégué général de la fédération nationale des corps gras (FNCG), interrogé par France info : « on n’alerte pas le consommateur sur des choses qui n’existent pas. Il n’y a pas d’alerte sanitaire sur l’hexane actuellement ».
Greenpeace France appelle néanmoins les pouvoirs publics et en particulier le ministère de la Santé :
- à interdire l’utilisation de l’hexane comme solvant d’extraction dans tous les produits alimentaires français, qu’ils soient à destination des êtres humains ou des animaux d’élevage ;
- à interdire l’importation et la vente de produits alimentaires contenant des résidus d’hexane ;
- à rendre obligatoire l’étiquetage des « auxiliaires technologiques » (dont l’hexane) sur tous les produits ;
- à relancer la recherche sur la toxicité chronique de l’hexane. « La limite maximale de résidus qui s’appuie sur des études datant de 1996, fournies par les industriels eux-mêmes », explique Greenpeace.